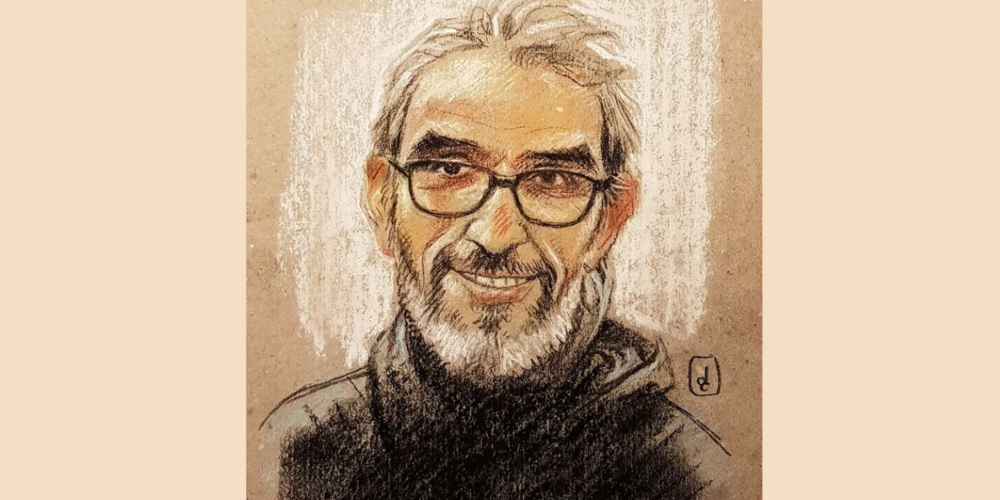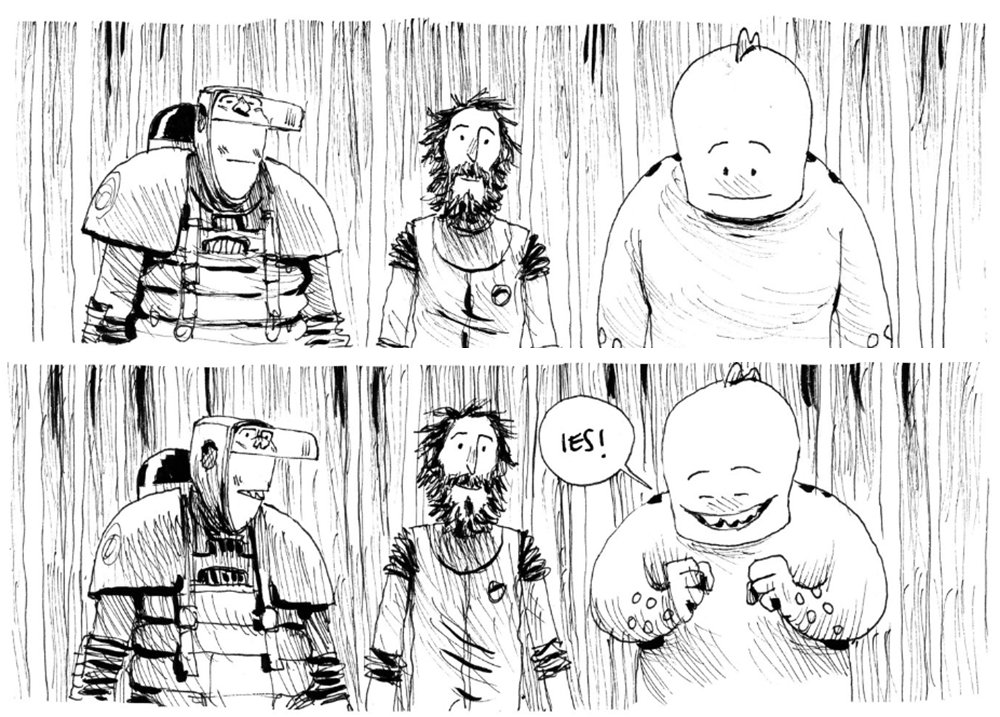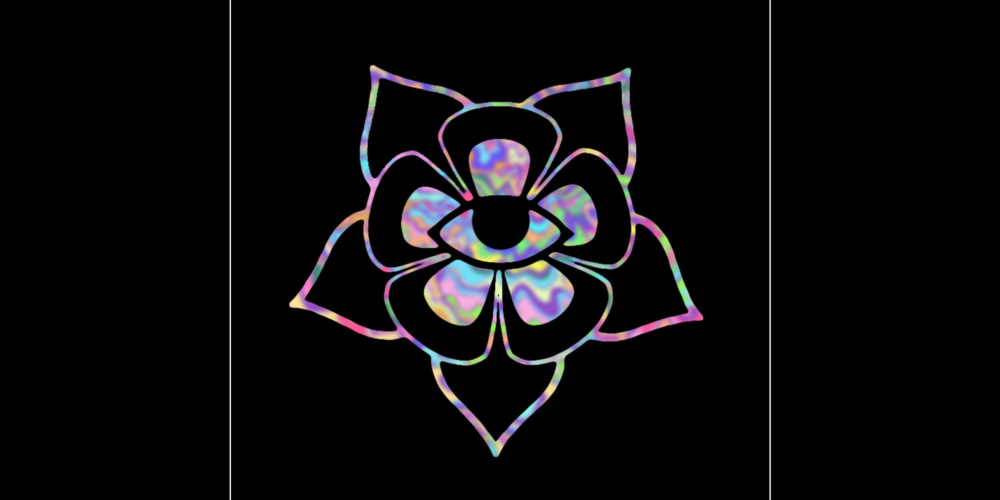It Turns Pale. Comment nier cet album de Cosse ?! Les compositions et ambiances sont soignées. Les mélodies accrochent et bercent l’oreille. Ranger le groupe dans la case noise est trop réducteur. Floyd Atema participe à la magie de l’opus. Ce shaman de l’émotion pure enregistre des sons atypiques. On le sait grâce au chanteur-guitariste Nils Bö. Il nous raconte son vécu… son expérience fut inoubliable !

Dans votre manière de composer, quelque chose a radicalement changé entre le premier et nouvel album ?
Artistiquement, on n’a pas voulu changer drastiquement. Il y a des morceaux qui font vraiment le pont entre l’EP sorti en 2020 et cet album. Maintenant, on avait une envie d’ouvrir plus de portes. On se dirigeait vers des approches différentes de l’EP, avec des morceaux un peu plus simples comme « Easy Things » ; plus simples mais non moins profonds.
On est au début d’une carrière. On n’a pas envie de s’enfermer dans quelque chose. On voulait ouvrir des branches pour ne pas se coincer dans un genre. Ce qui a beaucoup changé, c’est aussi le fait de partir deux semaines en studio avec un producteur. Il y a eu une vraie recherche pour chaque morceau de chaque son de guitare, chaque son de snare, voilà… à chaque morceau, on s’est creusé la tête pour savoir comment sonner.
Vous avez découvert du nouveau matos, une fois sur les lieux.
Totalement, ouais. On était dans au studio Katzwijm perdu aux Pays-Bas, à Voorhuit. Il y avait de vieux instruments, de vieux accordéons, des sortes de guitares faites maison, une snare des années trente, c’était une caisse claire super épaisse, presque difficile à jouer.
Floyd Atema, notre producteur, exposait souvent ses propres idées. Il posait des micros dans des tuyaux d’aspirateur, dans des casseroles avec des clous à l’intérieur. Il y avait un rapport au studio qui était assez cool. Le studio, ça peut être quelque chose de très classique, avec des techniciens qui posent soigneusement leurs micros. Là, c’est vrai qu’il y avait un rapport assez fun avec l’enregistrement.
Ces sons participent-ils à l’ambiance de l’album ? Matthew Bellamy enregistrait le bruit de sa braguette pour le second album de Muse. A l’écoute de leur morceau, on n’entend pas spécialement sa braguette. Ici, comment s’entendent vos sons atypiques ?
La résonance qu’il y a dans l’aspirateur crée comme un effet provenant d’une minuscule pièce. Donc ça crée un son très particulier. Après, on vient mixer ça par-dessus le mix existant. Ca ajoute une sorte de couleur.
Pensez-vous utiliser encore ces techniques pour le prochain album ? Ou viserez-vous encore plus haut, en utilisant d’autres ustensiles ?
(rire) Nan, écoute, c’est une bonne question. Pour la prochaine fois, on verra. Peut-être qu’on enregistrera dans les pièces différentes d’une maison. On ferait ça en fonction de l’acoustique, mais aussi de ce que peut raconter le lieu. Il y a des lieux qui sont vraiment chargés de quelque chose. C’était vraiment le cas du studio Katzwijm. Il y a des groupes qui passent là-bas depuis une vingtaine d’années, si ce n’est plus. Ce sont plusieurs groupes rock, de choses similaires à ce qu’on fait. Il y a vraiment une énergie particulière sur ces lieux. C’est toujours inspirant, au-delà de ces techniques, de faire face à des lieux qui portent certains vécus.
En parlant de techniques, on ne pouvait pas passer à côté d’une personnalité. On l’a déjà cité. Cet homme jouait un rôle fort quant à la conception de It Turns Pale. Je parle bien sûr de votre ingé son, Floyd Atema. Que retenir après vos séjours à ses côtés ?
Floyd, c’est quelqu’un qui a su nous rappeler que réaliser un enregistrement, ce n’est pas une formalité. Il se passe vraiment quelque chose. On est en train de figer une émotion. Et pour ça, il faut la vivre au moment où elle est captée. Parfois, lors de l’enregistrement des voix, je me lançais, je chantais le morceau comme j’ai l’habitude de le chanter. Puis, il m’arrêtait et me disait : « OK, ça parle de quoi ? ».
Je lui expliquais un petit peu, il comprenait et on se relançait. Puis, il m’arrêtait en plein milieu en me demandant pourquoi je parlais de ce que je chantais. Pendant que les autres étaient en cabine, je lui racontais alors des choses personnelles, intimes. Le but n’était pas d’aller dans mon intimité. A l’instant où il a senti que je vivais des moments de fragilité, il m’a stoppé pour relancer l’enregistrement. C’était fort. J’étais devenu sensible. C’est clair que ça se transmettait dans l’enregistrement. Floyd, plus qu’un ingénieur du son ou producteur, c’est aussi quelqu’un qui… ne pratique pas la psychologie, mais qui, à ce stade, est carrément mystique (rire). Il fait ça avec beaucoup de respect. Ouais, c’était une rencontre très forte. C’est quelqu’un d’une constance… pendant deux semaines, il était hyper droit, aucune saute d’humeur.
Si je comprends bien, il ne vous poussait pas dans vos retranchements. Ses démarches étaient plutôt bienveillantes.
Oui. Il y avait une forme de bienveillance, mais aussi la volonté d’aller chercher un point de tension. Il nous a poussé, non pas dans nos retranchements, mais aux bons endroits.
Ca influencera ta manière de composer à l’avenir.
Complètement. L’expérience fut bouleversante. Notamment, quant aux textes, à ce qu’on dit, ce qui dit la musique. Tout devenait assez évident.
Parlons cette fois de votre dernier clip en date. J’adore les plans et décors de « Easy Things ». Ils servent un texte intéressant. Les paroles de la chanson nous invitent à se lâcher. Actuellement, la réalité est dure à encaisser. Les Français sont en désaccord avec leur gouvernement. L’Ukraine est en cendres. Les dirigeants continuent d’organiser des jeux sportifs dans des pays sans foi, ni loi. Je me disais, finalement, votre meilleur moyen pour lâcher prise, c’est d’être musicien.
(rire). Je ne sais pas. (rire again) Je ne pense pas que ça soit la seule manière de lâcher prise. Typiquement, « Easy Things », ça vient d’une de mes expériences de plongée sous-marine. Quand on fait de la plongée profonde, il y a un moment où tu ne peux plus remonter à la surface comme tu le veux. Tu dois passer par des paliers. Tu bascules dans un monde très particulier. La lumière se fait rare. A chaque bouffée d’air, c’est comme si tu en inspirais six fois plus, donc tu entends tout ton organisme fonctionner, ton cœur battre, fin… c’est vraiment un autre environnement. Tu es en apesanteur. Tu n’as plus accès à l’autre monde que tu connais. L’exercice demande une certaine acceptation de la situation pour pouvoir la vivre convenablement. « Easy Things » se réfère un peu à cela, à cette idée de lâcher prise face à quelque chose de terrifiant, inconnu, pour vivre quelque chose pleinement, sans se bloquer. On passe tous par des phases de cette ampleur, où on doit lâcher prise. Que ce soit un deuil, faire son coming out… ces moments dans la vie où il faut lâcher prise, accepter et vivre le truc pleinement.
Interview menée par brunoaleas
Photos ©Céline Non